À cette époque, c'était encore la lune de miel entre Sabena et Swissair. Les deux compagnies tentaient de se partager une partie des marchés. La concurrence entre les autres compagnies aériennes était féroce. Bruxelles servait de « hub », de plate-forme de répartition et de redistribution entre les grandes lignes internationales et les vols européens de secours, pour Zurich qui commençait à saturer. Cela avait pour conséquence que l'aéroport de Bruxelles national servait pratiquement de gare de transit pour Swissair. Et dans ces vols européens transitait toute une faune étrange venue des quatre coins du monde
À l'aéroport international de Genève, le vol de Bruxelles se pose en retard comme tous les jours sur le tarmac de Cointrin. Maintenant, la nuit est totale. L'avion roule lentement en taxi pour se rendre au terminal. Je patiente pour sortir de l'avion en rassemblant mon ordinateur portable et ma petite valise contenant mes effets personnels. Sur les vols courts européens, j'ai pris l'habitude de toujours prendre mes quelques bagages en cabine. Cela évite les pertes de bagages, et l'on gagne du temps à l'arrivée. Enfin, on protège son bien professionnel le plus précieux : son PC (personnel computer).
Les portes de l'avion s'ouvrent et je m'enfile dans les longs couloirs souterrains qui mènent au contrôle des frontières. Tous les couloirs qui viennent des terminaux convergent vers ce point de passage obligé. Mais à cette heure, il n'y a pas trop de monde. Pourtant, je dois faire le bon choix. En effet, il y a deux postes de contrôle ouverts l'un à côté de l'autre pour absorber le flux des passagers. Et si l'on fait le mauvais choix, on perd facilement un quart d'heure. Je parie sur la file de gauche. Mon voisin de siège se glisse dans la file de droite sans un regard.
J'ai perdu, je manque de chance. Dans ma file, quelques personnes avant moi, une femme habillée de façon bigarrée, accompagnée d'enfants, qui ont des difficultés avec la police des frontières. La personne juste derrière moi me déclare que cette étrangère ne dispose pas des visas nécessaires et que le garde-frontière veut refouler la famille. Une discussion éclate entre cette famille visiblement désemparée et les gardes-frontières inflexibles. Vraisemblablement, ils ne se comprennent pas. Le ton monte en deux langues différentes entre le gendarme et la femme. Les enfants commencent à pleurer. La file de droite passe sans problème. Ce langage de sourds arrête toute ma file, et le public, qui piétine d'impatience, râle.
Je ronge mon frein et ces pauvres gens semblent de plus en plus malheureux. Lorsqu'un homme au teint basané, surgissant de derrière moi, parlant correctement le français, explique qu'il peut faire la traduction en turc pour ces personnes. Les gardes-frontières retrouvent leur calme et invitent l'interprète providentiel, ainsi que la famille désemparée à rejoindre leur bureau. Toute la file débloquée se détend comme par miracle. Tout le monde y va de son sourire compatissant envers les enfants et la femme qui s'éloignent de la file. Et le contrôle reprend à un rythme accéléré.
Enfin, c'est mon tour. Je passe le sésame, traverse la salle de récupération des bagages, et franchis la douane sans incident. Dans le hall des arrivées, il y a une petite cohue entre les gens qui attendent, les familles qui se retrouvent, les amoureux transis et puis, seulement, ceux qui essaient de se frayer un passage vers la sortie.
Je me retrouve enfin à l'extérieur et je peux calmement humer l'air frais. Je me dirige lentement vers les ascenseurs du parking souterrain afin de récupérer ma voiture de location. Je prends l'ascenseur seul, descends deux étages, et me retrouve au niveau partiellement réservé aux compagnies de location de voitures.
Le dimanche à cette heure-ci, la petite compagnie régionale de location de voitures avec laquelle nous sommes en contrat n'a plus de guichets ouverts. Nous avons une convention dans laquelle une petite voiture est à notre disposition, les clés dissimulées derrière le pare-soleil.
Le problème est qu'il faut retrouver cette voiture sans connaître son emplacement précis et c'est toujours une recherche fastidieuse. Après la réservation téléphonique, nous connaissons bien entendu le numéro de plaque, mais il y a vraiment beaucoup de voitures de même type et ce modèle de voiture est tellement courant. Enfin, je prends mon mal en patience et j'examine la première série de voitures de location en essayant de repérer celle qui m'est dévolue. Il y a des centaines de voitures de toutes les sortes éclairées par la lumière blafarde des tubes au néon. Je passe en revue la première série de voitures, et arrivé au bout de la file, je tourne à gauche et remonte la deuxième rangée de voitures. Je suis fatigué, j'en ai marre. Je voudrais trouver ma voiture au plus vite et me reposer. Dans le fond du parking, des hommes discutent avec véhémence. J'entends des éclats de voix sans rien comprendre. Pour un parking souterrain, les lieux sont relativement sûrs. Il est surveillé par des caméras et il y a régulièrement des patrouilles de la police spéciale de l'aéroport. Des gardes privés, accompagnés de chiens de race berger allemand, font également des rondes. Les voix s'estompent et le calme revient. Je continue ma quête en cherchant désespérément cette Fiatrouge qui, décidément, doit être rangée au fond de ce foutu parking.
Tout à coup, deux bruits secs claquent dans la nuit. Et une galopade s'ensuit rapidement du coin où les hommes discutaient quelques instants plus tôt. Les ombres disparaissent presque instantanément par un escalier de secours. Une femme que je n'avais pas remarquée se met à crier et quelqu'un déclenche l'alarme anti-agression. La sirène se met à hurler. Je me retourne et regarde dans la direction où se trouvait le groupe quelques instants auparavant. Une forme grise est couchée par terre. Je m'approche lentement un peu abasourdi. Un homme gît à terre, la figure tournée vers le sol dans une petite flaque rouge foncé, éclairé par intervalles réguliers par le clignotant jaune de l'alarme.
Tout cela s'est passé tellement vite. La femme est maintenant à côté de moi. Elle est très émotionnée et parle nerveusement, elle aurait déclenché l'alarme. Je ne comprends rien. Une voix ferme, masculine, intime l'ordre de dégager sans s'éloigner ; je dois rester à disposition de la justice ! La police de l'aéroport était arrivée sur les lieux et prenait la situation en main. Un jeune policier demande une ambulance par radio, alors qu'un autre annonce d'une voix étouffée :
« Je crois qu'il est mort ! »
Je regarde cette jeune femme qui parle le français avec un accent étranger difficile à reconnaître. Elle est élancée, fine, cheveux clairs, courts, habillée d'un pantalon très ajusté et d'une veste entrouverte qui laisse deviner un t-shirt moderne. Elle doit avoir une quarantaine d'années, et elle est plutôt jolie.
Un policier me demande mon passeport et prend note de mes premières déclarations. Son collègue vérifie par radio, enfin, je suppose. Il demande visiblement des confirmations avec mon permis de travail et mon passeport en main. Maintenant, il y a beaucoup de monde. Je me demande d'où peuvent sortir toutes ces personnes. Il semble que les magistrats du parquet soient attendus. Un homme avec un stéthoscope, le médecin du SAMU, agenouillé au-dessus du corps, fait une constatation officielle du décès et les ambulanciers patientent avec le brancard.
Le policier qui nous avait interpellés m'appelle à l'écart. Il me rend mes papiers et me demande de le conduire à ma voiture. Je lui explique le mode de fonctionnement de notre système de location. Il ne dit mot, et me fait signe d'aller à la voiture. Je reprends mes effets personnels et je me remets à la recherche de la voiture, le policier me suit. Je continue et trouve enfin la voiture. Le policier m'arrête et entre lui-même dans la voiture et de sa main il tâte derrière le pare-soleil et trouve les clés. Il contrôle qu'elles correspondent. Il coupe le moteur, garde la clé et me demande les papiers et le contrat de location. Je veux mettre les mains dans la boîte à gants, lorsque le policier m'arrête sèchement ! La boîte à gants est vide ! Le policier me fixe droit dans les yeux. Je me sens bizarre. J'essaie de lui expliquer et je commence sérieusement à sentir la fatigue.
Il est maintenant quatre heures du matin et je suis vanné. Je voudrais pouvoir dormir, mais après cette visite d'explication et de contrôle au poste de police, je suis perturbé. Mais j'essaie cependant de me reposer quelques heures avant la réunion, le briefingrisque d'être ardu demain ; non, aujourd'hui, dans quelques heures...
Le radio-réveil me tire brutalement de mon sommeil perturbé. J'ai dû faire un mauvais rêve, j'ai assisté à un crime. La carte de visite professionnelle d'un officier de police avec un numéro de téléphone mis en évidence est déposée sur ma table de nuit. Je n'ai pas rêvé. Je me souviens : il m'a fermement invité à le contacter spontanément si un souvenir, même insignifiant, ou un détail, me revenait. Après m'avoir fait la leçon sur ce qu'il appelait notre « combine de loc. ». Il m'avait fait comprendre que je serais convoqué ultérieurement et que si je rentrais en Belgique, je devais personnellement l'avertir.
Bon, il me restait quelques heures avant l'arrivée des collègues de France qui devaient arriver par le TGV de Paris. Et puis j'avais ce déjeuner avec le directeur administratif du client qui était notre « facilitateur ». Terme utilisé par notre cabinet pour désigner une autorité interne au client qui devait nous aider dans notre mission en nous transmettant un maximum d'informations et nous permettre de réaliser nos démarches administratives, telles que convocation des personnes à interviewer – allant du cadre supérieur au simple fonctionnaire –, réservation de salle de réunion, communication des pièces comptables, procès-verbaux mêmes confidentiels, documents d'analyse. C'était un personnage clé dans notre organisation. Il devait avoir assez d'autorité pour nous ouvrir les portes nécessaires à notre mission, mais il ne pouvait pas être impliqué directement dans les processus d'audit et de restructuration, car il ne pouvait être juge et partie ou encore moins pouvoir tirer un avantage quelconque de la relation privilégiée qui allait forcément se développer avec le consultant.
Monsieur Boos était parfait dans son rôle : fonctionnaire, Genevois d'origine, bien intégré au tissu social et politique. De plus, ce directeur administratif était à deux années de la retraite. Il n'était pas mis en cause, ni directement ni indirectement, dans notre audit et il le savait. Mais malgré cela, il n'appréciait pas du tout que des étrangers, non-fonctionnaires, viennent auditer les services dans lesquels il avait fait sa carrière et encore moins que ces étrangers fassent des propositions de restructuration. À part cela, c'était un homme agréable, intègre. Je pense que secrètement, il appréciait aussi que nous disions tout haut ce qui se disait tout bas, et il reconnaissait nos compétences. Mais il était inquiet pour certains de ses collègues qui allaient souffrir suite à notre rapport. Néanmoins, nous avions des relations de travail agréables et nos déjeuners de travail étaient empreints d'un mélange de cordialité et de cette réserve traditionnelle que les Genevois, de pure souche, réservent à ceux qui ne sont pas nés dans la cité de Calvin.
Nous avions un rendez-vous au Brillant, brasserie traditionnelle genevoise où nous devions préparer notre dernier comité de pilotage. C'est devant cette instance que les consultants présentaient officiellement le rapport d'audit. En principe, ces séances étaient placées sous la plus haute confidentialité. Mais depuis longtemps, l'expérience nous avait appris que ces recommandations étaient rarement respectées. Et nous étions encore contents quand les personnes incriminées dans ces rapports ne réglaient pas leurs comptes aux auditeurs par presse interposée. Mais cela faisait partie du jeu normal. En effet, beaucoup de personnes ressentaient ces audits comme de super contrôles teintés de nombreuses injustices et doublés d'agressions personnelles. Il est vrai que beaucoup d'hommes publics, qu'ils soient politiques ou capitaines d'entreprise, préféraient « faire faire » le sale boulot par des experts externes. Et derrière les missions d'audit se profilaient souvent des restructurations drastiques. Et il faut ajouter qu'elles étaient souvent orientées.
/0/15061/coverbig.jpg?v=30de6468739b102ab8c1a7b76c9f03d7)








































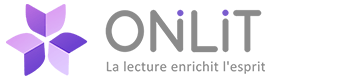

/0/4991/coverbig.jpg?v=7aa50b9f0a39d127b28588b3374b0764)
/0/5340/coverbig.jpg?v=23ebba1b8dba78a2e6d98041c5aff3a5)
/0/12912/coverbig.jpg?v=30ee5b98e9a2fdaccf5ad39dee7c85b9)
/0/14745/coverbig.jpg?v=0937abd94bb7702c05e21c025f7a62b3)
/0/15104/coverbig.jpg?v=a6dcb425aa50329f326ff94a8e5fb72d)