Avant la fin de nous, ma vie se passe en France. Les copains, la famille, la fête, l'aventure à droite à gauche, les petits boulots, une énième séparation et me revoilà en quête de perdition. Je m'improvise reporter d'image spécialisé dans la protection de l'environnement. Sorte de paparazzi défenseur de la cause environnementale et animal si vous voulez. Métier ingrat mais enfin quelque chose qui me fait vibrer, une vraie bataille à laquelle participer. Je travaille pour une coopérative couvrant des sujets un peu partout dans le monde. Nous squattons les locaux de la rédaction et notre rémunération vient des poches de quelques généreux donateurs.
2052 Guyane Française, installé dans un hôtel miteux je prépare mon prochain reportage photo. Il portera sur la forêt Amazonienne, sa faune, sa flore, son massacre à chair vive. Elle qui saigne du nord au sud et d'est en ouest, elle aurait besoin d'un bon garrot, mais à la place nous décidons de l'amputer toujours un peu plus haut vers les poumons puis le cœur. Je ne suis qu'à quelques kilomètres de la frontière Brésilienne que je passerai incognito une fois mon attirail d'aventurier complété. C'est pour demain.
Sur terre, le bois est l'origine de tout, il oxygène, abrite, réchauffe, meuble une maison, s'imprime, se lit, se brûle, se recycle... Il est devenu rare, vulnérable. Depuis le début du siècle, la forêt amazonienne est l'atout économique majeur du Brésil. Il est donc tout naturel que l'on ne puisse en observer l'exploitation de trop près, et cela vaut d'autant plus pour les journalistes étrangers qui ne passent plus les postes de frontière depuis quelques années déjà. Il est aussi encore le temps ou avec la valeur de l'argent, nous pouvons toujours acheter le regard des hommes.
Jour-J, adieu hôtel miteux à présent je me faufile vers l'ouest à travers les mailles du filet laissant traîner quelques billets par ci par là. Voilà, je quitte les routes et pénètre au cœur de la sublime Amazonie. J'arpenterais pendant une semaine cette vaste forêt tropicale, un territoire primaire, centre vierge de la main de l'homme constituant un ultime refuge à la vie sauvage. 70 % de la flore a été ravagé au cours des 100 dernières années, je contemple alors avec à la fois émerveillement et tristesse les derniers remparts de mère Nature qui entonne doucement son chant de mort. Un jour ou l'autre, son heure viendra en notre nom, celui des hommes. Je ne suis pas seul, il y a des petits villages qui apparaissent au milieu des arbres. Les habitants sont d'un autre siècle, arriérés, craintifs... Je ne m'approche pas plus que ça. Pas de photos, ils me prendraient pour un sorcier à abattre.
Arrivé à un village de pêcheurs aux abords de l'Amazone, je monte à la poupe d'un petit remorqueur pour descendre le fleuve, et rejoindre la ville de Manaus, épicentre historique de la déforestation amazonienne. En chemin, les abords boisés de la rivière se font de plus en plus silencieux jusqu'à en devenir totalement muets sur quelques kilomètres. Le temps d'une courte transition entre le grand opéra de la faune Amazonienne et l'écho pas si lointain d'un concert de pelleteuses disharmonieuses.
L'aube, par précaution j'accoste en amont du port de Manaus et poursuis ma route à pied. La végétation est couverte de fines particules poussiéreuses virevoltantes dans le ciel, faisant escale dans les troncs, les feuillages, au sol. Je trouve une route goudronnée et monte à l'arrière d'un pick-up d'ouvriers incrédules qui m'emmène droit en première ligne. Les yeux rivés sur la route qui défile, je découvre un champ de souches destiné aux futures plantations de soja et au loin, des arbres s'effondrant au sol après décapitation. Les ténèbres trinquent à la santé du chaos.
À l'approche de l'exploitation, je sautais de l'arrière du pick-up pour me tenir à l'écart du chantier et me cachais derrière un immense tas de bois en partance pour l'Europe. Cette pyramide atteignait les 8 mètres de hauteur et derrière elle, il y en avait d'autres toutes aussi grandes. Au-dessus de celles-ci s'échappaient d'épais nuages de fumée noire préliminant l'obscurité. La totalité du chantier était délimitée d'une longue clôture et d'un mirador avec en contrebas, un grand baraquement de taule faisant office de quartier général lui-même entouré d'un lieu de camp rudimentaire destiné aux ouvriers. Je photographiais la centaine de travailleurs armés de tronçonneuse qui – comme l'infanterie précédant les blindés – suivaient les camions à grue déjà en route pour décrocher leurs premiers troncs. Le jour se levait à peine et tous partaient à la conquête des richesses de la forêt amazonienne. Certains ouvriers devraient encore à l'école mais l'économie mondiale n'attend plus rien des savants. Il faut produire, il faut dézinguer, tête baissée. Sur le chantier, tout semblait se dérouler comme d'ordinaire lorsqu'à l'orée de la forêt jaillit subitement un fort groupe d'indigènes criards et peinturlurés d'argile rouge. Ils étaient armés de javelots d'arcs et de flèches.
« Os nativos ! » ; « Índios ! », tétanisés par cette vision, les ouvriers donnent l'alerte et prennent la fuite laissant champ libre aux assaillants pour saboter leur matériel. Un signal d'alarme retentit depuis le quartier général et une patrouille de jeep de l'armée brésilienne se dirige à toute vitesse en direction des rebelles désormais à couvert et prêts à combattre. Une première volée de javelots et de flèches blesse grièvement plusieurs soldats tandis que le reste d'entre eux déchargent leurs armes automatiques en direction du peuple des bois. Ces guerriers redoutables occupent parfaitement le terrain en se dissimulant derrière de larges souches de bois et les camions à bennes, profitant de tout répit pour décocher une flèche et se déplacer d'un abri à l'autre. Non sans compter quelques pertes, ils forment un demi-cercle autour du corps de jeeps qui en sous-nombre ne sait plus où faire feu.
Le renfort d'une armada lourdement armée mit fin à la charge infernale des indigènes et les contraint à se replier vers la forêt en se faisant tirer dessus comme du bétail. « Tactactactactactac », les détonations résonnent encore dans ma tête. Les soldats ramassèrent leurs blessés et capturèrent une dizaine d'indigènes n'ayant pu échapper à la contre-attaque. La bataille était perdue, mais le sabotage du matériel offrait un répit de quelques jours à la forêt. M'étant rapproché au plus près du combat pour mes photos, je fus également repéré et arrêté par une seconde patrouille ratissant l'arrière.
Tout mon matériel fut saisi et l'on m'emmena avec les guerriers indigènes dans une cellule à ciel ouvert située juste en dessous du grand mirador. La fin de journée passa, je fus interrogé et remis en cellule où je pus faire connaissance avec un indigène parlant brièvement le portugais. Son nom était Tupyaawo et il appartenait à la tribu des Ipitaléwos (j'écris ces noms comme je les entends). J'appris qu'ils menaient un combat face à l'homme moderne depuis des décennies. Ils n'avaient eu recours aux armes que depuis très récemment lorsque leur territoire se retrouva directement menacé par l'avancée dévorante de la déforestation. Le quatrième soir, un petit commando indigène armé de sarbacanes lança un raid victorieux pour libérer ses prisonniers et je pris la fuite avec eux. Ils se débarrassèrent de nos gardes en une poignée de seconde et en un léger contre temps, Tupyaawo s'infiltra à l'intérieur du baraquement pour récupérer mes affaires. Nous marchèrent dans l'obscurité d'une nuit sans Lune à travers la forêt Amazonienne dont les indigènes connaissaient fort heureusement chaque arpent de terre. Au petit matin, nous poursuivîmes notre route à bord de longues pirogues taillées dans de larges troncs d'arbres. La rivière sur laquelle nous glissions m'était totalement inconnue et il en valait de même pour notre destination. Qu'il était bon de retrouver le flot de la nature si tranquille et pleine de vie. Je m'accordai alors un court repos du corps et de l'esprit pour pleinement percevoir toute cette splendeur qui défilait devant mes yeux.
Nous accostâmes le long d'une petite plage de sable brun. M'étant endormi pendant la traversée je fus réveillé par mes compagnons qui m'invitèrent à les suivre jusqu'à leur village. Celui-ci se trouvait caché quelque part derrière un amas d'arbres millénaires que nous traversâmes en file indienne. En descendant un sentier invisible, je débusquais du regard des sentinelles à la respiration immobile qui – ornées de leur camouflage terre-argile – faisaient partie intégrante de la végétation environnante. Tous les 500 mètres, l'un de mes nouveaux camarades imitait des chants d'oiseaux pour signaler notre présence aux prochains guetteurs.
Après une heure de marche, notre groupe s'arrêta. Tupyaawo se retourna me souhaitant la bienvenue chez lui mais ne percevant aucune habitation alentour, je lui demandai où donc se trouvait son village. Pour seule réponse à ma question, il leva le bras en direction du ciel sans quitter mon regard et me dit « casas na arvores ». J'élevai alors mes yeux vers la cime des arbres et découvris au-dessus de moi un village suspendu. Des bâtisses, des terrasses, des lieux de vies... Encastrés dans l'épaisse écorce des arbres millénaires, tout un réseau relié par des passerelles de bois et de lianes. Un cocon de paix. Le peuple d'en haut me fixait furtivement, la présence de l'homme blanc sur leur territoire n'était assurément pas de bon augure. Cependant, Tupyaawo parvint à les rassurer en quelques palabres et l'on m'accorda une entrevue avec le cacique. Ainsi, nous grimpâmes au village et je pus m'entretenir avec le cacique qui m'offrit la vive hospitalité. Cela car nous défendions la même cause.
/0/13654/coverbig.jpg?v=e3e3cb8ee53188abc37dd1f1b6ed4c33)



















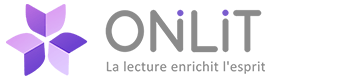

/0/14841/coverbig.jpg?v=bf25a176b00c418376355bc8252f0915)
/0/2639/coverbig.jpg?v=897c5a9341e4a516025e6fde89691d5f)
/0/5684/coverbig.jpg?v=276ec381d02543e34a13d8aa4d3c1bf9)
/0/10593/coverbig.jpg?v=dc26b086b1ae47776dd241d7b7886b18)
/0/12945/coverbig.jpg?v=2adf711547fc1233cdb8e9eef77f1b4a)
/0/12852/coverbig.jpg?v=036a03ba43d5cb7c59c0ebe84b05c7a4)